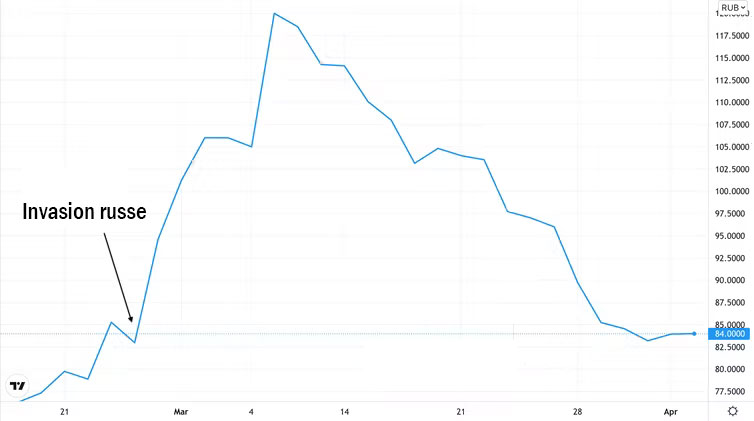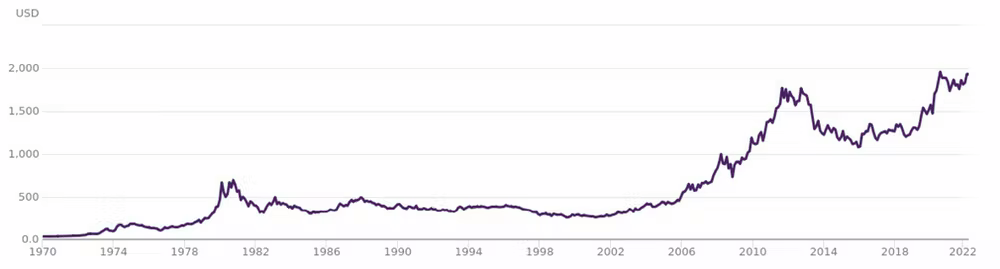L’invasion de l’Ukraine par la Russie a poussé la Suède et la Finlande vers l’OTAN. Il a peut-être aussi commencé à ouvrir les portes de l’Union européenne à l’Ukraine. Jeudi, la Commission européenne a recommandé au Conseil de confirmer la perspective d’adhésion à l’UE de l’Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait officiellement demandé l’adhésion du pays à l’UE quatre jours après l’invasion des forces russes en février, déclarant que l’objectif de l’Ukraine était d’être « avec tous les Européens et d’être égal à eux ».
La recommandation de la Commission n’est que la première partie d’un long voyage, qui prend normalement plus d’une décennie. La décision définitive sera entre les mains des dirigeants de l’Union européenne qui se réuniront les 23 et 24 juin à Bruxelles pour aborder l’épineuse question.
Ces avis reposent sur l’évaluation réalisée par la Commission à la lumière des trois séries de critères d’adhésion à l’UE approuvés par le Conseil européen : les critères politiques, les critères économiques et l’aptitude du pays à assumer les obligations découlant de l’adhésion à l’UE (l’acquis de l’UE).
Selon la Commission européenne, l’Ukraine est bien avancée dans la mise en place d’institutions stables garantissant la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et la stabilité macroéconomique et financière, entre autres.
La candidature de l’Ukraine à devenir un candidat officiel à l’UE, première étape sur la voie de l’adhésion à part entière, a remporté le soutien de la France, de l’Allemagne et de l’Italie. Alors que des alliés de l’Ukraine soutiennent qu’elle mérite une attention particulière, mais d’autres hésitent à assouplir les exigences habituelles.
La semaine prochaine, les 27 chefs de gouvernement de l’UE se réuniront pour discuter les demandes d’adhésion à l’UE présentées par l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie à la lumière des avis de la Commission. Tous doivent donner le feu vert pour que cela se poursuive.
🇺🇦 Ukraine has clearly shown commitment to live up to European values and standards.
— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) June 17, 2022
Following our assessment, we recommend to the @EUCouncil that Ukraine should be given the perspective to become a member of the European Union. pic.twitter.com/WyOsmnQknx