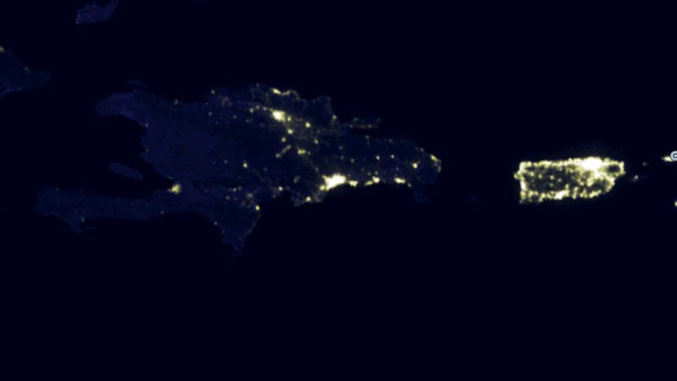Avec 7 milliards de dollars d’actifs et plus d’un milliard d’adeptes, l’Église catholique est la religion la plus riche du monde. Mais la Banque du Vatican est accusée de corruption et d’encouragement au blanchiment d’argent. Et tandis que le pape François a promis de nettoyer ses finances, il y a des appels pour que la banque poursuive les affaires pénales.
Selon The Economist, des inspecteurs de Moneyval, le chien de garde de l’Europe pour le blanchiment d’argent, entament cette semaine une visite dans un Vatican déchiré par la dissidence et animé de spéculations conspiratrices. Le 24 septembre, le pape François a pris la décision inaccoutumée de dépouiller le cardinal Giovanni Angelo Becciu, l’un de ses lieutenants les plus puissants, de ses droits et devoirs de cardinal. Il a également renvoyé le cardinal Becciu de son poste de chef d’un département du Vatican.
«J’ai été traité comme le pire des pédophiles», aurait déclaré le cardinal. On prétend qu’il a acheminé de l’argent du Vatican et de l’église italienne vers une organisation caritative dirigée par son frère – une accusation que son frère nie. Il aurait également confié des affaires du Vatican à deux autres frères. Mais beaucoup dans la ville pensent que les accusations sont un prétexte pour expulser un prélat qui, selon François, a entravé ses efforts pour réformer les finances opaques du Vatican.
En juin dernier, Reuters a rapporté que la police du Vatican avait fait une descente dans le département chargé de l’entretien et de la restauration de la basilique Saint-Pierre, saisissant des documents et des ordinateurs pour une enquête sur des soupçons de corruption. Un raid similaire a eu lieu en octobre de l’année dernière pour des scandales financiers présumés liés à la Banque du Vatican et un investissement de 200 millions de dollars américains dans des propriétés de luxe dans le quartier de Chelsea à Londres.
En avril, après avoir été innocenté des crimes sexuels commis sur des enfants par la plus haute cour d’Australie, dans une interview accordée à Sky News Australia, le cardinal George Pell, l’ancien ministre des Finances du pape François, a déclaré que certains responsables de l’église pensaient qu’il était poursuivi par les autorités australiennes en raison des ennuis qu’il avait provoqué au Vatican avec des réformes financières.
Dans un discours prononcé à la réunion finale du 28e Forum économique et environnemental de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Mgr Charles Balvo, nonce apostolique en République tchèque et chef de la délégation du Saint-Siège, a souligné que «la corruption est un réel danger pour la paix et la sécurité de notre région de l’OSCE. »
L’archevêque a également déclaré : « Il y a lieu de s’inquiéter du fait que l’énorme quantité de fonds débloqués pour la pandémie de Covid-19 a déjà attiré des activités criminelles, notamment le risque que ceux qui ont le plus besoin d’un soutien financier restent sans l’aide urgente nécessaire. »
Le pape François reconnaît l’existence de la corruption au Vatican. Le 1er juin 2020, le Pape avait publié de nouvelles procédures et contrôles juridiques pour la transparence, le contrôle et la concurrence dans les procédures de passation des marchés publics du Saint-Siège et de l’État de la Cité du Vatican.
Une action notable pour la mise en œuvre de la nouvelle loi anti-corruption du Pape François est la signature d’un mémorandum d’accord sur la lutte contre la corruption par le préfet du Secrétariat à l’économie et le vérificateur général du Vatican. Selon un message du bureau de presse du Saint-Siège le 18 septembre, l’accord signifie que les bureaux du Secrétariat à l’économie et du vérificateur général « collaboreront encore plus étroitement pour identifier les risques de corruption ».
Le cardinal George Pell, ancien préfet du Secrétariat à l’économie du Vatican que le pape François a créé il y a six ans pour surveiller et réformer les finances du Vatican, a délivré un message le 30 juin sur la menace que la corruption financière représente pour la mission de l’Église.