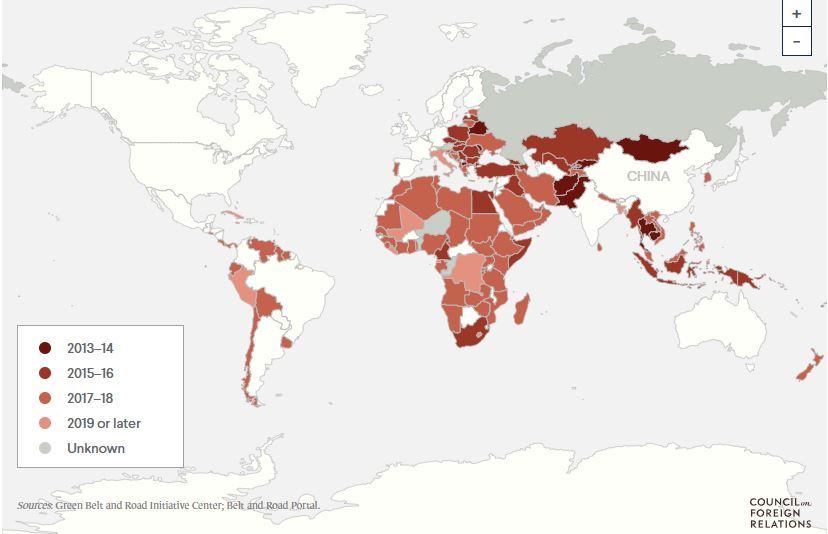Aujourd’hui, le Liban est en chute libre, propulsé par une série de crises en cascade. Les statistiques reflétant la spirale descendante rapide du Liban sont ahurissantes. Les données racontent l’histoire de la transformation d’un pays autrefois très instruit et à revenu intermédiaire connu pour sa diversité et sa sophistication urbaine en un État défaillant et appauvri. Beaucoup craignent que le pays ne devienne la nouvelle catastrophe humanitaire de la région.
Le catalyseur de la spirale descendante du Liban a commencé avec la crise financière de 2019 entraînée par l’augmentation de la dette dans une économie basée sur un « système de Ponzi ». La pandémie de COVID a encore aggravé la crise, approfondissant sa récession économique et surtaxant son système de santé publique.
The Economist rapporte qu’environ trois quarts de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté. 80 % des Libanais manquent d’argent pour acheter une nourriture adéquate, car la monnaie locale, la lire, s’est dépréciée d’environ 130 % en 2020. En 2021, elle a perdu plus de 90 % de sa valeur. Le pays souffre d’hyperinflation, une rareté au Moyen-Orient. Les prix de certains produits alimentaires ont augmenté de plus de 600 %. L’économie s’est contractée de 20 % l’année dernière et devrait se contracter de 10 % supplémentaires cette année.
Les finances du pays sont tellement sous pression que le gouvernement a mis en place des mesures fiscales drastiques pour réduire les dépenses publiques afin de réduire la dette publique et le déficit budgétaire. Ces politiques incluent la réduction ou l’élimination des subventions sur les biens essentiels, entraînant de longues coupures d’électricité à travers le pays et des pénuries de biens tels que l’essence. Les chefs militaires avertissent que les politiques gouvernementales ont dévalué les salaires des fonctionnaires, y compris le personnel militaire, créant une situation de sécurité instable.
Dans un rapport récent, la Banque mondiale a noté que l’effondrement économique du Liban était probablement l’une des pires crises au monde depuis 150 ans. Les gens sont frustrés et indignés par le système politique fondé sur la corruption. L’état actuel des affaires est une sorte de système redistributif transférant la richesse aux plus puissants du pays. En conséquence, la richesse est concentrée entre les mains de quelques familles tandis que la classe moyenne s’appauvrit.
Le 4 août 2019, Beyrouth a subi l’une des plus grandes explosions non nucléaires de l’histoire. C’était une catastrophe évitable créée par l’homme. Cette explosion dévastatrice dans le port de Beyrouth a coûté la vie à plus de 200 personnes et en a blessé des milliers. Il a également détruit plusieurs quartiers du cœur de la ville.
Personne n’a été tenu pour responsable à ce jour et l’enquête a fait l’objet d’ingérences politiques. Pourtant, les premières indications suggèrent que des années d’incompétence et de corruption du gouvernement ont joué un rôle clé. Elles indiquent également que l’explosion est l’un des exemples les plus flagrants d’actes répréhensibles publics dans l’histoire moderne.
La Banque mondiale a qualifié la crise au Liban de délibérée. À l’instar de l’explosion du port de Beyrouth, les décideurs étaient conscients des problèmes, mais ont échoué de manière spectaculaire à faire quoi que ce soit pour les résoudre. Des manifestations de masse spontanées ont fait descendre plus d’un million de personnes dans les rues. Beaucoup appelaient les hauts responsables à « démissionner ou à pendre ».
Début août, le Premier ministre libanais Hassan Diab a annoncé la démission de son cabinet, en réponse à l’indignation suscitée par l’explosion catastrophique à Beyrouth. Diab, professeur et ancien ministre de l’Éducation, n’occupe ce poste que depuis janvier. Il a fait face à bon nombre des mêmes défis qui ont forcé son prédécesseur, Saad Hariri, à démissionner lorsqu’il a pris la relève. Même avant la récente catastrophe, le Liban subissait des protestations généralisées et persistantes contre des allégations de corruption politique et de frustration face à une crise économique qui s’aggravait.
La constitution libanaise a institué un partage collégial du pouvoir au sein de l’exécutif qui implique l’établissement d’une grande coalition permettant la participation politique des principales confessions religieuses libanaises au gouvernement. Ce système a été blâmé pour l’instabilité politique et la division passées du pays. La nature du système au Liban a rendu difficile pour les citoyens de s’organiser efficacement contre le leadership — et d’obtenir un changement politique significatif.
Après la guerre civile de 1975-90 qui a opposé divers intérêts, le pays était principalement dirigé par des seigneurs de la guerre et des oligarques. L’élite politique a utilisé le secteur public pour faire avancer et protéger ses intérêts aux dépens de l’État. La classe dirigeante parvient à contrôler les principales ressources économiques du Liban, générant des rentes importantes et partageant le butin d’un État dysfonctionnel. Dans le processus, le secteur public est devenu de plus en plus gouverné par la corruption et le népotisme.
En août, l’élite dirigeante libanaise a désigné le milliardaire Najib Mikati, l’homme le plus riche du pays, au poste de Premier ministre à un moment où les masses libanaises sont tombées dans la pauvreté. Aujourd’hui, un nouveau gouvernement a été formé au Liban dirigé par M. Mikati, mettant fin à une impasse politique de 13 mois causée par l’incapacité ou la réticence de l’élite politique à éviter ou à atténuer la crise économique actuelle.
Le nouveau Premier ministre libanais n’est pas une nouvelle figure de la politique du pays. C’est un musulman sunnite qui a été choisi comme Premier ministre par intérim en avril 2005, après la mort de Rafik al-Hariri, un multimilliardaire qui a fait fortune dans la construction, et qui a été cinq fois Premier ministre du Liban après la guerre civile de 1975-90. Mikati a servi trois mois jusqu’à ce qu’une élection soit remportée par une alliance de partis sunnites, druzes et chrétiens dirigés par le fils de Hariri, Saad. Le milliardaire de 65 ans a également été nommé à nouveau Premier ministre en juin 2011, démissionnant en mai 2013 et restant par intérim jusqu’en février 2014.