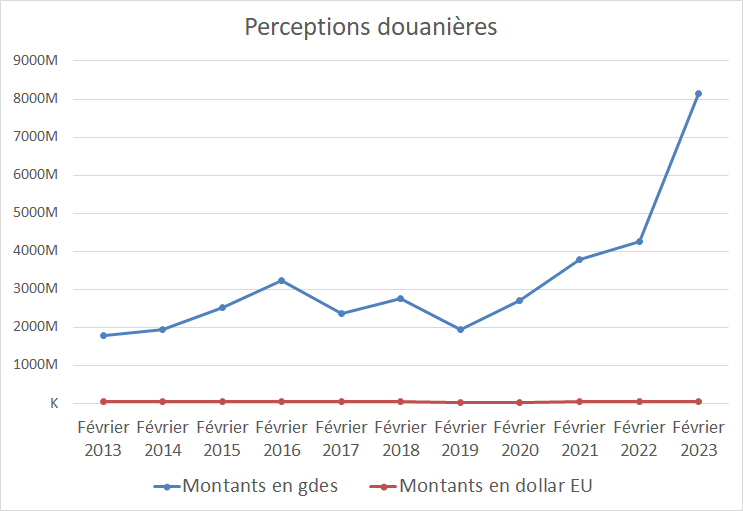Nous, Henry Christophe, Clervaux, Vernet, Gabart, Pétion, Geffrard, Toussaint Brave, Raphaël, Lalondrie, Romain, Capoix, Magny, Cangé, Daut, Magloire Ambroise, Yayou, Jean-Louis François, Gérin, Moreau, Férou, Bazelais, Martial Besse,
Tant en notre nom particulier, qu’en celui du peuple d’Hayiti qui nous a légalement constitués les organes fidèles et les interprètes de sa volonté,
En présence de l’Être Suprême, devant qui les mortels sont égaux, et qui n’a répandu tant d’espèces de créatures différentes sur la surface du globe, qu’aux fins de manifester sa gloire et sa puissance, par la diversité de ses oeuvres,
En face de la nature entière dont nous avons été si injustement et depuis si longtemps considérés comme les enfants réprouvés,
Déclarons que la teneur de la présente Constitution est l’expression libre, spontanée et invariable de nos cœurs et de la volonté générale de nos constituants,
La soumettons à la sanction de Sa Majesté l’empereur Jacques Dessalines, notre libérateur, pour recevoir sa prompte et entière exécution.
Déclaration préliminaire.
Article premier.
Le peuple habitant l’île ci-devant appelée Saint-Domingue, convient ici de se former en État libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l’univers, sous le nom d’Empire d’Hayiti.
Article 2.
L’esclavage est à jamais aboli.
Article 3.
Les citoyens Hayitiens sont frères entre eux ; l’égalité aux yeux de la loi est incontestablement reconnue, et il ne peut exister d’autre titre, avantages ou privilèges, que ceux qui résultent nécessairement de la considération et en récompense des services rendus à la liberté et à l’indépendance.
Article 4.
La loi est une pour tous, soit qu’elle punisse, soit qu’elle protège.
Article 5.
La loi n’a point d’effet rétroactif.
Article 6.
La propriété est sacrée, sa violation sera rigoureusement poursuivie.
Article 7.
La qualité de citoyen d’Hayiti se perd par l’émigration et par la naturalisation en pays étranger, et par la condamnation à des peines afflictives et infamantes. Le premier cas emporte la peine de mort et la confiscation des propriétés.
Article 8.
La qualité de citoyen Hayitien est suspendue par l’effet des banqueroutes et faillites.
Article 9.
Nul n’est digne d’être Hayitien, s’il n’est bon père, bon fils, bon époux, et surtout bon soldat
Article 10.
La faculté n’est point accordée aux pères et mères de déshériter leurs enfants.
Article 11.
Tout citoyen doit posséder un art mécanique
Article 12.
Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire, à titre de maître ou de propriétaire et ne pourra à l’avenir y acquérir aucune propriété.
Article 13.
L’article précédent ne pourra produire aucun effet tant à l’égard des femmes blanches qui sont naturalisées Hayitiennes par le gouvernement, qu’à l’égard des enfants nés ou à naître d’elles. Sont compris dans les dispositions du présent article, les Allemands et Polonais naturalisés par le gouvernement.
Article 14.
Toute acception de couleur parmi les enfants d’une seule et même famille, dont le chef de l’État est le père, devant nécessairement cesser, les Hayitiens ne seront désormais connus que sous la dénomination génériques de Noirs.
De l’Empire.
Article 15.
L’Empire d’Hayiti est un et indivisible ; son territoire est distribué en six divisions militaires.
Article 16.
Chaque division militaire sera commandée par un général de division
Article 17.
Chacun de ces généraux de division sera indépendant des autres, et correspondra directement avec
l’empereur ou avec le général en chef nommé par Sa Majesté.
Article 18.
Sont parties intégrantes de l’Empire les îles ci-après désignées : Samana, la Tortue, la Gonâve, les Cayemites, l’île à Vache, la Saône, et autres îles adjacentes.
Du Gouvernement.
Article 19.
Le gouvernement d’Hayiti est confié à un premier magistrat qui prend le titre d’empereur et Chef suprême de l’armée.
Article 20.
Le peuple reconnait pour Empereur et Chef suprême de l’armée, Jacques Dessalines, le vengeur et le libérateur de ses concitoyens ; on le qualifie de Majesté ainsi que son auguste épouse l’impératrice.
Article 21.
La personne de Leurs Majestés est sacrée et inviolable.
Article 22.
L’État accordera un traitement fixe à Sa Majesté l’impératrice dont elle jouira même après le décès de l’empereur, à titre de princesse douairière.
Article 23.
La couronne est élective et non héréditaire.
Article 24.
Il sera affecté, par l’État, un traitement annuel aux enfants reconnus par Sa Majesté l’empereur.
Article 25.
Les enfants mâles reconnus par l’empereur seront tenus, à l’instar des autres citoyens, de passer successivement de grade en grade, avec cette seule différence que leur entrée au service datera dans la quatrième demi-brigade de l’époque de leur naissance.
Article 26.
L’Empereur désigne son successeur et de la manière qu’il le juge convenable, soit avant, soit après sa mort.
Article 27.
Un traitement convenable sera fixé par l’État à ce successeur, au moment de son avènement au trône.
Article 28.
L’Empereur, ni aucun de ses successeurs, n’aura le droit, dans aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, de s’entourer d’un corps particulier et privilégié à titre de garde d’honneur, ou sous toute autre dénomination.
Article 29.
Tout successeur qui s’écartera des dispositions du précédent article ou de la marche qui lui aura été tracée par l’empereur régnant, ou des principes consacrés par la présente Constitution, sera considéré et déclaré en état de guerre contre la société. En conséquence, les conseillers d’État s’assembleront, à l’effet de prononcer sa destitution, et de pourvoir à son remplacement par celui d’entre eux qui en aura été jugé le plus digne, et s’il arrivait que ledit successeur voulût s’opposer à l’exécution de cette mesure, autorisée par la loi, les généraux conseillers d’État feront un appel au peuple et à l’armée, qui de suite leur prêteront main-forte et assistance pour maintenir la liberté.
Article 30.
L’Empereur fait, scelle et promulgue les lois, nomme et révoque, à sa volonté, les ministres, le général en chef de l’armée, les conseillers d’État, les généraux et autres agents de l’Empire, les officiers de l’armée de terre et de mer, les membres des administrations locales, les commissaires du gouvernement près les tribunaux, les juges et autres fonctionnaires publics.
Article 31.
L’Empereur dirige les recettes et dépenses de l’État, surveille la fabrication des monnaies ; lui seul en ordonne l’émission, en fixe le poids et le type.
Article 32.
A lui seul est réservé le pouvoir de faire la paix ou la guerre, d’entretenir des relations politiques et de contracter au dehors.
Article 33.
Il pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense de l’État, distribue les forces de terre et de mer suivant sa volonté.
Article 34.
L’Empereur, dans le cas où il se tramerait quelque conspiration contre la sûreté de l’État, contre la Constitution ou contre sa personne, fera de suite arrêter les auteurs ou complices, qui seront jugés par un conseil spécial.
Article 35.
Sa Majesté seule a le droit d’absoudre un coupable ou de commuer sa peine.
Article 36.
L’Empereur ne formera jamais aucune entreprise dans la vue de faire des conquêtes ni de troubler la paix et le régime intérieur des colonies étrangères.
Article 37.
Tout acte public sera fait en ces termes : « L’Empereur d’Hayiti et le chef suprême de l’armée, par la grâce de de Dieu et la loi constitutionnelle de l’État. »
Du Conseil d’État.
Article 38.
Les généraux de division et de brigade sont membres-nés du conseil d’État et le composent.
Des ministres.
Article 39.
Il y aura dans l’Empire deux ministres et un secrétaire d’État :
Le ministre des finances ayant le département de l’intérieur ;
Le ministre de la guerre ayant le département de la marine.
Article 40. Du ministre des finances et de l’intérieur.
Du ministre des finances et de l’intérieur : Les attributions de ce ministre comprennent l’administration générale du Trésor public, l’organisation des administrations particulières, la distribution des fonds à mettre à la disposition du ministre de la guerre et autres fonctionnaires, les dépenses publiques, les instructions qui règlent la comptabilité des administrations et des payeurs de division, l’agriculture, le commerce, l’instruction publique, les poids et mesures, la formation des tableaux de population, les produits territoriaux, les domaines nationaux, soit pour la conservation, soit pour la vente, les baux à ferme, les prisons, les hôpitaux, l’entretien des routes, les bacs, salines, manufactures, les douanes, enfin la surveillance et la fabrication des monnaies, l’exécution des lois et arrêtés du gouvernement à ce sujet.
Article 41.
Du ministre de la guerre et de la marine : Les fonctions de ce ministre embrassent la levée, l’organisation, l’inspection, la surveillance, la discipline, la police et le mouvement des armées de terre et de mer, le personnel et le matériel de l’artillerie et du génie, les fortifications, les forteresses, les poudres et salpêtres, l’enregistrement des actes et arrêtés de l’empereur, leur renvoi aux armées et la surveillance de leur exécution ; il veille spécialement à ce que les décisions de l’empereur parviennent promptement aux militaires ; il dénonce aux conseils spéciaux les délits militaires parvenus à sa connaissance et surveille les commissaires de guerre et officiers de santé.
Article 42.
Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté publique et la Constitution, de tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle, de toute dissipation de deniers à eux confiés ; ils sont tenus de présenter, tous les trois mois, à l’empereur, l’aperçu des dépenses à faire, de rendre compte de l’emploi des sommes qui ont été mises à leur disposition, et d’indiquer les abus qui auraient pu se glisser dans les diverses branches de l’administration.
Article 43.
Aucun ministre en place ou hors de place ne peut être poursuivi en matière criminelle, pour fait de son administration, sans l’adhésion personnelle de l’empereur.
Article 44.
Du secrétaire d’État : Le secrétaire d’État est chargé de l’impression, de l’enregistrement et de l’envoi des lois, arrêtés, proclamations et instructions de l’empereur ; il travaille directement avec l’empereur pour les relations étrangères, correspond avec les ministres, reçoit de ceux-ci les requêtes, pétitions et autres demandes qu’il soumet à l’empereur, de même que les questions qui lui sont proposées par les tribunaux ; il renvoie aux ministres les jugements et les pièces sur lesquels l’empereur a statué.
Des tribunaux.
Article 45.
Nul ne peut porter atteinte au droit qu’a chaque individu de se faire juger à l’amiable par des arbitres à son choix. Leurs décisions seront reconnues légales.
Article 46.
Il y aura un juge de paix dans chaque commune ; il ne pourra connaître d’une affaire s’élevant au delà de cent gourdes, et lorsque les parties ne pourront se concilier à son tribunal, elles se pourvoiront par-devant les tribunaux de leur ressort respectif.
Article 47.
Il y aura six tribunaux séant dans les villes ci-après désignées : A Saint-Marc, au Cap, au Port-au-Prince, aux Cayes, à l’Anse-à-Veau et au Port-de-Paix. L’Empereur détermine leur organisation, leur nombre, leur compétence et le territoire formant le ressort de chacun. Ces tribunaux connaissent de toutes les affaires purement civiles.
Article 48.
Les délits militaires sont soumis à des conseils spéciaux et à des formes particulières de jugement. L’organisation de ces conseils appartient à l’empereur, qui prononcera sur les demandes en cassation contre les jugements rendus par lesdits conseils spéciaux.
Article 49.
Des lois particulières seront faites pour le notariat et à l’égard des officiers de l’état civil.
Du culte.
Article 50.
La loi n’admet pas de religion dominante.
Article 51.
La liberté des cultes est tolérée.
Article 52.
L’État ne pourvoit à l’entretien d’aucun culte ni d’aucun ministre.
De l’administration.
Article 53.
Il y aura, dans chaque division militaire, une administration principale, dont l’organisation, la surveillance appartiennent essentiellement au ministre des finances.
Dispositions générales.
Article premier.
A l’empereur et à l’impératrice appartiennent le choix, le traitement et l’entretien des personnes qui composent leur cour.
Article 2.
Après le décès de l’empereur régnant, lorsque la révision de la Constitution aura été jugée nécessaire, le Conseil d’État s’assemblera à cet effet et sera présidé par le doyen d’âge.
Article 3.
Les crimes de haute trahison, les délits commis par les ministres et les généraux, seront jugés par un conseil spécial nommé et présidé par l’empereur.
Article 4.
La force armée est essentiellement obéissante, nul corps armé ne peut délibérer.
Article 5.
Nul ne pourra être jugé sans avoir été légalement entendu.
Article 6.
La maison de tout citoyen est un asile inviolable.
Article 7.
On peut y entrer en cas d’incendie, d’inondation, de réclamation partant de l’intérieur, ou en vertu d’un ordre émané de l’empereur ou de toute autre autorité légalement constituée.
Article 8.
Celui-là mérite la mort qui la donne à son semblable.
Article 9.
Tout jugement portant peine de mort ou peine afflictive, ne pourra recevoir son exécution, s’il n’a été confirmé par l’empereur.
Article 10.
Le vol est puni en raison des circonstances qui l’auront précédé, accompagné ou suivi.
Article 11.
Tout étranger habitant le territoire d’Hayiti sera, ainsi que les Hayitiens, soumis aux lois correctionnelles
et criminelles du pays.
Article 12.
Toute propriété qui aura ci-devant appartenu à un blanc français est incontestablement et de droit confisquée au profit de l’État.
Article 13.
Tout Hayitien qui, ayant acquis une propriété d’un blanc français, n’aura payé qu’une partie du prix stipulé par l’acte de vente, sera responsable, envers les domaines de l’État, du reliquat de la somme due.
Article 14.
Le mariage est un acte purement civil et autorisé par le gouvernement.
Article 15.
La loi autorise le divorce dans les cas qu’elle a prévus et déterminés.
Article 16.
Une loi particulière sera rendue concernant les enfants nés hors mariage.
Article 17.
Le respect pour ses chefs, la subordination et la discipline sont rigoureusement nécessaires.
Article 18.
Un code pénal sera publié et sévèrement observé.
Article 19.
Dans chaque division militaire, une école publique sera établie pour l’instruction de la jeunesse.
Article 20.
Les couleurs nationales sont noires et rouges.
Article 21.
L’agriculture, comme le premier, le plus noble et le plus utile de tous les arts, sera honorée et protégée.
Article 22.
Le commerce, seconde source de la prospérité des États, ne veut et ne connaît point d’entraves.
Il doit être favorisé et spécialement protégé.
Article 23.
Dans chaque division militaire, un tribunal de commerce sera formé, dont les membres seront choisis par l’empereur, et tirés de la classe des négociants.
Article 24.
La bonne foi, la loyauté dans les opérations commerciales seront religieusement observées.
Article 25.
Le gouvernement assure sûreté et protection aux nations neutres et amies qui viendront entretenir avec cette île des rapports commerciaux, à la charge par elles de se conformer aux règlements, us et coutumes de ce pays.
Article 26.
Les comptoirs, les marchandises des étrangers seront sous la sauvegarde et la garantie de l’État.
Article 27.
Il y aura des fêtes nationales pour célébrer l’Indépendance, la fête de l’empereur et de son auguste Épouse, celle de l’Agriculture et de la Constitution.
Article 28.
Au premier coup de canon d’alarme, les villes disparaissent et la nation est debout.
***
Nous, mandataires soussignés, mettons sous la sauvegarde des magistrats, des pères et mères de famille, des citoyens et de l’armée, le pacte explicite et solennel des droits sacrés de l’homme et des devoirs du citoyen ;
La recommandons à nos neveux, et en faisons hommage aux amis de la liberté, aux philanthropes de tous les pays, comme un gage signalé de la bonté divine, qui, par suite de ses décrets immortels, nous a procuré l’occasion de briser nos fers et de nous constituer en peuple libre, civilisé et indépendant.
Et avons signé, tant en notre nom privé qu’en celui de nos commettants.
Signé : H. Christophe, Clervaux, Vernet, Gabart, Pétion, Geffrard, Toussaint-Brave, Raphaël, Lalondrie, Romain, Capoix, Magny, Cangé, Daut, Magloire Ambroise, Yayou, Jean-Louis François, Gérin, Moreau, Férou, Bazelais, Martial Besse.
Présentée à la signature de l’Empereur, la Constitution de l’Empire fut sanctionnée par lui.
Vu la présente Constitution,
Nous, Jacques Dessalines, Empereur Ier d’Hayiti et chef suprême de l’armée, par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l’État,
L’acceptons dans tout son contenu, et la sanctionnons, pour recevoir, sous le plus bref délai, sa pleine et entière exécution dans toute l’étendue de notre empire ;
Et jurons de la maintenir et de la faire observer dans son intégrité jusqu’au dernier soupir de notre vie.
Au Palais impérial de Dessalines, le 20 mai 1805, an II de l’Indépendance d’Hayiti, et de notre règne le premier.
Signé : Dessalines.
Par l’Empereur :
Le Secrétaire général,
Signé : Juste Chanlatte.