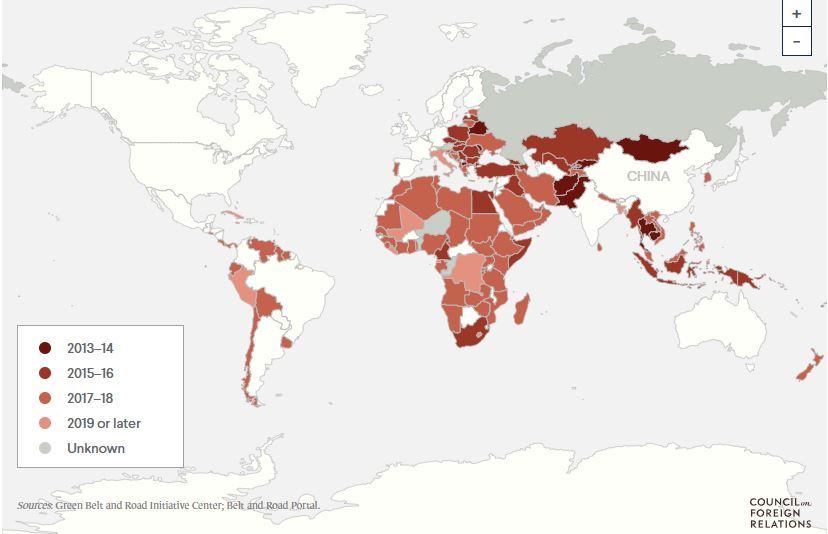La semaine dernière, le prix du brut West Texas Intermediate (WTI), la référence américaine, a dépassé les 80 dollars pour la première fois depuis novembre 2014. Le brut Brent a atteint un sommet en trois ans. La récente remontée des prix de l’énergie reflète un rebond de la demande mondiale qui contribue aux pénuries d’énergie dans les grandes économies comme la Chine, l’Europe et l’Inde. En Haïti, les répercussions des prix élevés des produits pétroliers seront graves avec un gouvernement incapable de percevoir des impôts pour continuer les subventions pétrolières au milieu de la violence des gangs et des troubles politiques.
Alors que la crise énergétique frappe de grandes économies dans un contexte de reprise économique mondiale, elle est une préoccupation notable en Haïti, car la petite économie souffre souvent de pénuries de produits pétroliers en raison d’un manque de réserves étrangères suffisantes pour financer les importations, ressources fiscales pour les subventions, et d’un marché efficace.
Haïti, qui enregistre constamment d’énormes déficits commerciaux, manque souvent de réserves de change suffisantes pour financer ses produits pétroliers à travers le Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement (BMPAD). Selon les responsables gouvernementaux, il y a souvent un décalage entre la livraison des produits pétroliers au secteur privé et le paiement. En conséquence, le gouvernement n’a pas toujours les moyens de payer ses fournisseurs qui facturent des frais supplémentaires pour le temps qu’ils passent dans les ports d’Haïti incapables de livrer les marchandises.
La banque centrale puise dans ses réserves épuisantes pour payer les factures afin de faciliter l’importation de produits pétroliers. En août dernier, le gouverneur de la Banque de la République d’Haïti (BRH) a indiqué que la banque centrale avait déboursé 550 millions de dollars pour permettre au pays de payer la facture des produits pétroliers cet exercice 2021.
La terreur des gangs contrôlant la majeure partie du pays n’arrange pas non plus la situation. Leurs activités, ainsi que les instabilités politiques, ont étouffé l’économie haïtienne. En conséquence, le gouvernement n’a pas atteint son objectif de recettes fiscales et a considérablement réduit ses dépenses.
Le gouvernement haïtien avait connu de graves déficits budgétaires en partie à cause de ses subventions aux produits pétroliers. Une telle subvention implique l’utilisation de ressources publiques rares et de recettes fiscales sacrifiées. Pour l’exercice 2021, l’État a financé plus de 21 milliards de gourdes au titre de la subvention pétrolière.
Malgré l’effort budgétaire du gouvernement pour maintenir les prix bas à la pompe, la marchandise est toujours hors de portée et rare. La subvention pétrolière, de plus en plus inabordable par le gouvernement, le marché noir a prospéré tandis que la PNH détourne de précieuses ressources de la lutte contre les gangs pour empêcher la vente d’essence de manière informelle.
De plus, les gangs ont prouvé leur capacité à choquer facilement le marché en contrôlant les artères autour des terminaux pétroliers, dont Varreux, représentant 70 % de la capacité de stockage d’Haïti. On assiste trop souvent à de longues files d’attente aux pompes à travers la capitale. De nombreuses stations essence sont fermées parce que la violence perturbe la livraison de carburant. Les compagnies pétrolières disent qu’ils en ont assez et demandent au gouvernement de faire ce qu’il faut pour sécuriser le flux de ce produit, qui est essentiel à l’économie.
À Port-au-Prince 3e circonscription, les gangs opèrent sur la route nationale numéro 2, qui donne accès au terminal de Thor, et une route vitale reliant quatre départements au reste du pays d’une dizaine de départements. Cette artère logistique vitale pour la distribution des produits pétroliers dans le pays est impraticable.
Limité au nord par le port de Port-au-Prince, Thor est le principal goulot d’étranglement énergétique d’Haïti qui importe la totalité de son carburant. Les carburants arrivent aux terminaux pétroliers de Thor et Varreux, prêts à être consommés.
La hausse du prix du pétrole sur le marché international crée une pression fiscale supplémentaire sur le budget de l’État, qui est déjà incapable de financer les investissements dans les projets de développement du pays ou de payer les services publics essentiels comme le ramassage des ordures.
Quand le carburant est disponible, il peut coûter jusqu’à cinq fois les prix cibles du gouvernement. Vendus à des prix prohibitifs, les produits pétroliers contribuent à l’augmentation du coût de la vie, créant plus de pression sociale sur une économie déjà volatile.
« À chaque fois qu’il faut s’approvisionner en produits pétroliers, c’est un casse-tête. Avec la hausse des prix sur le marché international, ce financement sera certainement supérieur à 30 milliards de gourdes », a expliqué le ministre de l’Économie et des Finances d’Haïti, M. Michel Patrick Boisvert évoquant la subvention des produits pétroliers qui a coûté plus de 21 milliards de gourdes à l’État haïtien au cours de l’exercice 2020-2021.
Les prix au comptant du pétrole brut brent étaient en moyenne de 74 $ le baril (b) en septembre, en hausse de 4 $/b par rapport à août et de 34 $/b par rapport à septembre 2020. Les prix resteront proches de 81 $/b pour le reste de 2021, soit 10 $/b de plus que les prévisions précédentes.