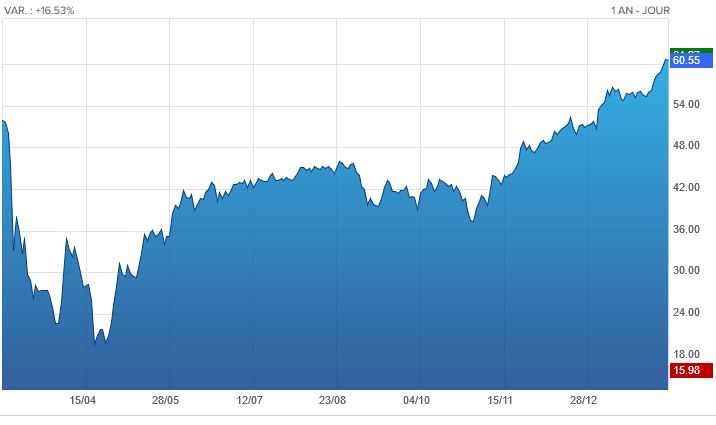1) Résumé exécutif – Ce rapport, préparé conjointement par le Service des droits de l’homme (SDH) du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH) et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), présente les conclusions et les principales préoccupations en matière de droits de l’homme en lien avec les manifestations qui ont eu lieu en Haïti du 6 juillet 2018 au 10 décembre 2019.
Cette période fut marquée par une intense mobilisation de l’opposition politique et de la société civile dans l’ensemble du pays, lors de six cycles de manifestations, en juillet, octobre et novembre 2018, ainsi qu’en février, juin et de septembre à décembre 2019. Alors que les manifestations ont débuté de manière généralement pacifique à l’été 2018, elles ont été de plus en plus marquées par la violence au fil du temps, notamment dans le contexte de l’imposition d’un nombre important de barricades sur les axes routiers lors des trois derniers cycles qui ont mené à la quasi-paralysie de certaines régions du pays.
Tout en reconnaissant le droit de réunion pacifique ainsi que les causes sous-jacentes des manifestations, telles que la dénonciation de la corruption et les revendications de la population ayant trait à un plus grand respect des droits économiques et sociaux, les enquêtes menées par le SDH portent sur les violations et abus des droits de l’homme commis dans le contexte de ces manifestations, l’impact de celles-ci sur l’accès aux droits de la population, et les mesures prises par l’État pour répondre à ces violations et abus. Dans ce cadre, le SDH a documenté des violations aux droits à la vie, à la sécurité de la personne, à un recours utile, ainsi qu’aux droits de réunion pacifique et de liberté d’expression. En outre, le SDH a documenté de quelle façon l’imposition de barricades a causé des violations au droit de circuler librement, aux droits à la santé, à l’éducation, à l’alimentation, et au droit des personnes privées de liberté d’être traitées avec humanité. Le SDH a également documenté l’impact des barricades sur l’administration de la justice.
En ce qui concerne les droits à la vie et à la sécurité de la personne, le SDH a identifié dans les dix départements du pays 131 personnes victimes de violations et abus commis lors des manifestations de 2018, dont 19 victimes étaient des femmes et neuf étaient mineures, et 567 personnes victimes de violations et abus perpétrés dans le cadre des manifestations de 2019, dont 43 victimes étaient des femmes et 47 des mineurs. Résultant principalement d’actions perpétrées par des acteurs non-étatiques et de sympathisants tant pro qu’anti-gouvernementaux (66% des abus et violations étant attribués à ces acteurs), mais aussi de violations liées à l’usage de la force par les forces de l’ordre (auteurs de 34% des abus et violations), ces violences ont culminé lors des manifestations qui se sont déroulées entre septembre et décembre 2019, où le plus grand nombre de violations et abus ont été documentés. Ainsi, le SDH a constaté une augmentation de 333% du nombre de victimes de violations de droits de l’homme et d’abus entre 2018 et 2019. Pour sa part, la Police nationale d’Haïti (PNH) a compté deux décès et 30 blessés dans ses rangs du fait des manifestations de 2018 et 2019.
Enfin, peu d’enquêtes ayant été ouvertes au sujet de ces abus et violations, aucun individu n’a encore été tenu responsable judiciairement pour ceux-ci, et aucune mesure de réparation n’a été offerte aux victimes.
En outre, les manifestations et les barricades érigées, notamment en 2019, ont grandement affecté la vie quotidienne de la population en restreignant la libre circulation, l’accès aux soins de santé (y compris aux soins de santé sexuelle et reproductive) et à l’éducation, et en posant des obstacles à la mise en œuvre du droit à l’alimentation. Cette situation a particulièrement affecté les personnes en situation de vulnérabilité, telles que celles ayant besoin de traitement médicaux et les personnes privées de liberté. Les attaques perpétrées contre des hôpitaux et ambulances, la fermeture des écoles en raison des violences, et les obstacles posés au ravitaillement en produits de première nécessité causés par les blocages de routes ont aussi sévèrement affecté le quotidien de la population sur l’ensemble du territoire. De plus, l’imposition de « droits de passage » à certaines barricades par des manifestants ou des délinquants, particulièrement entre septembre et décembre 2019, a représenté un fardeau économique additionnel pour les ménages aux ressources déjà limitées et a entravé leur capacité de circuler librement.
Ce rapport présente une série de recommandations fondées sur les obligations de la République d’Haïti en vertu du droit international et national. La mise en œuvre de ces recommandations est primordiale afin de protéger le droit de réunion pacifique, d’éviter la récurrence de violations des droits de l’homme dans le contexte de manifestations, et d’offrir un recours efficace aux victimes de violations et abus.
Dans le but de prévenir de futurs troubles sociaux, notamment dans le cadre du prochain cycle électoral, et de rétablir la confiance envers le gouvernement, il sera également essentiel pour l’État de s’attaquer aux griefs de la population, notamment sa colère face à la corruption incontrôlée et à l’impunité généralisée, à la persistance de la pauvreté, aux inégalités structurelles, à l’accès limité aux services sociaux, et autres échecs dans la mise en œuvre des droits économiques et sociaux qui permettrait d’assurer un niveau de vie adéquat à l’ensemble de la population.
Téléchargez le rapport complet