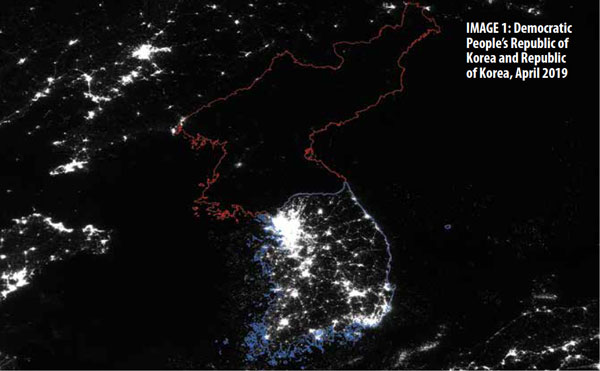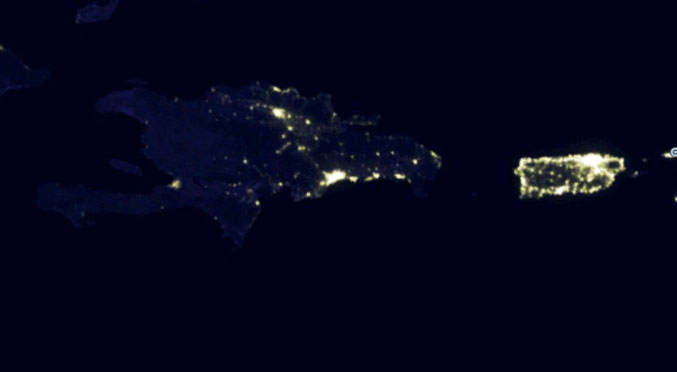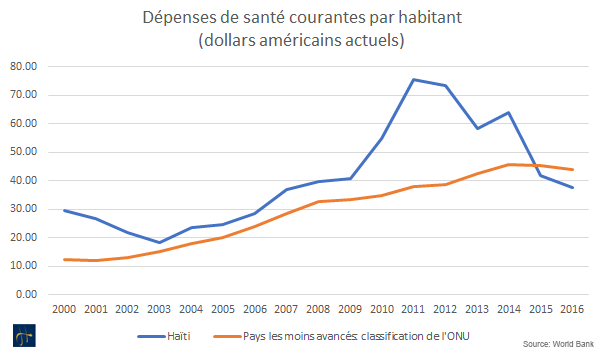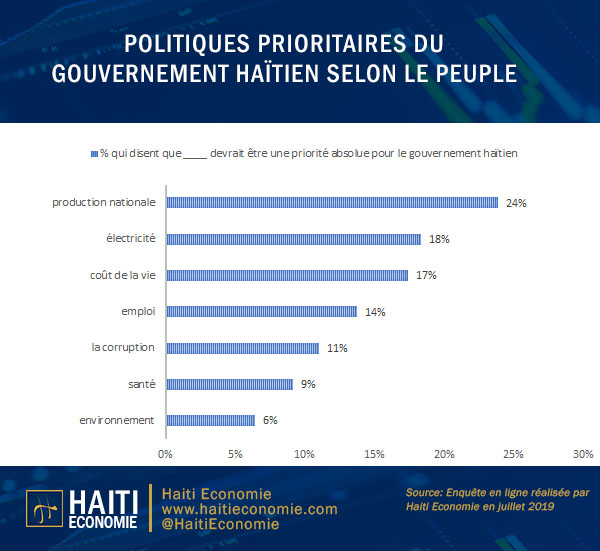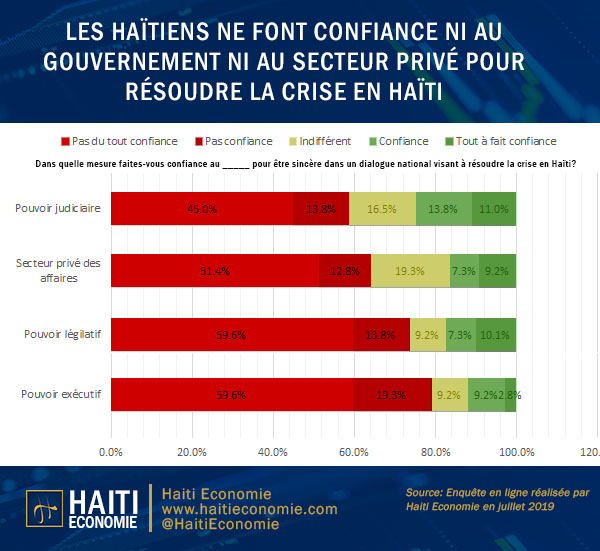En 2018, dans le monde entier, environ 626 milliards de dollars (USD) ont été envoyés par les migrants à des particuliers dans leur pays d’origine, soit une augmentation de 7% par rapport à 2017, année où ils étaient 584 milliards, selon la Banque mondiale.
La diaspora haïtienne a envoyé 3 milliards de dollars en Haïti. Ce chiffre record représente près de 31% du PIB du pays. Ces flux sont plus importants que l’aide publique au développement (APD), l’investissement direct étranger (IDE) et dépassent largement les exportations selon la dernière note d’information sur les migrations et le développement publiée par le Groupe de la Banque mondiale et le KNOMAD.
Envois de fonds en ALC en 2018
(Pourcentage du PIB, 2018)
Saint Vincent et la Grenadine
Source: World Bank, IMF Balance of Payments Statistic
D’après ce rapport, les envois de fonds des migrants vers les pays à revenu faible et intermédiaire (à l’exclusion de la Chine) sont plus élevés que l’IDE et l’aide au développement. Selon le FMI, la mesure dans laquelle les pays des Caraïbes dépendent des envois de fonds varie considérablement. Les envois de fonds ont représenté en moyenne 6,3% du PIB en 2011-15, plus que la moyenne mondiale (4,8% du PIB), la Guyane (13% du PIB), la Jamaïque (14% du PIB) et Haïti (22% du PIB) présentant une forte dépendance vis-à-vis de ces flux.
Parmi les pays d’Amérique latine
et des Caraïbes qui reçoivent le plus d’envois de fonds en 2018, Haïti dépend
le plus de ce flux de fonds. Les envois de fonds constituent une partie vitale
de l’économie et représentent une source majeure de revenus individuels
annuels. Par exemple, le PIB par habitant du pays était de 868,28 dollars,
tandis que les envois de fonds par habitant s’élevaient à 268,44 dollars, soit
près du tiers.
Envois de fonds en pourcentage du PIB par habitant (2018)
Envois de fonds
PIB par habitant
Source: World Bank
En 2017, environ 2 millions d’Haïtiens vivant à l’étranger contribuant en moyenne 1,98 milliard de dollars par an au cours des dix dernières années. Les montants sont significatifs par rapport au budget national du pays. Pour l’exercice 2017-2018, les dépenses totales du gouvernement s’élevaient à environ 2,2 milliards de dollars (sur la base du taux de change moyen de cet exercice), tandis que la diaspora avait envoyé 2,9 milliards de dollars à la fin de 2018.
En 2018, les cinq principaux pays destinataires des envois de fonds étaient l’Inde (78,6 milliards de dollars), Chine (67,4 milliards de dollars), Mexique (35,7 milliards de dollars), Philippines (33,8 milliards de dollars) et Égypte (28,9 milliards de dollars). En pourcentage du produit intérieur brut (PIB) pour 2018, les cinq principaux bénéficiaires étaient les économies les plus petites : Tonga, République kirghize, Tadjikistan, Haïti et le Népal.
Cette situation n’a pas vraiment changé, car en 2017 les principaux pays ayant reçu des envois de fonds en 2017 ont été l’Inde (65.4 milliards de dollars), la Chine (62.9 milliards), les Philippines (32.8 milliards) et le Mexique (30.5 milliards). Mais en part du PIB, les principaux bénéficiaires en 2017 étaient le Tadjikistan (49 %), la République kirghize (32%), le Népal (29 %), la République de Moldova (25 %), les Tonga (24 %), Haïti (31%) et l’Arménie (21 %).
Les envois de fonds de l’étranger sont des atouts économiques majeurs pour certains pays en développement. Les flux des comptes financiers contribuent largement au financement de l’investissement. Les transferts de fonds vers les pays en développement sont plus importants que l’aide publique au développement et plus stables que les flux de capitaux privés. Ainsi, une capacité réduite à recevoir des envois de fonds représenterait un risque important dans ces économies.
La taille de l’économie et la taille relative de la diaspora sont des facteurs importants pour le montant des envois de fonds à destination d’un pays et pour son incidence sur l’ensemble de l’économie. Des changements importants dans l’un de ces facteurs peuvent avoir un impact considérable sur le pays d’accueil. Par exemple, les États-Unis ont été le principal émetteur en 2017, enregistrant des sorties de fonds d’environ 68 milliards de dollars. Compte tenu de la taille relativement importante de la population haïtienne de migrants vivant aux États-Unis, de la taille relativement petite de l’économie du pays et du rapport entre les envois de fonds et le PIB, tout changement significatif de la vigueur de l’économie américaine ou de la politique d’immigration aura de profondes répercussions dans l’économie haïtienne.
Bien que l’économie américaine soit forte, le statut incertain de certains immigrants haïtiens constitue un risque considérable. De nombreux immigrés qui ont l’autorisation de vivre et de travailler aux États-Unis dans le cadre d’un programme appelé Statut de protection temporaire (Temporary Protected Status – TPS) sont confrontés à un avenir incertain alors que la Maison Blanche cherche à mettre fin à leur autorisation de rester dans le pays. Selon les estimations du Pew Research Center, il y avait environ 100 000 immigrants non autorisés en provenance d’Haïti aux États-Unis en 2016 et 46 000 immigrants haïtiens ont un statut de protection temporaire en 2018. Ils ont tous contribué aux envois de fonds en Haïti. L’approche peu accueillante de l’administration actuelle en matière d’immigration présente un risque majeur pour le flux de transferts vers Haïti.