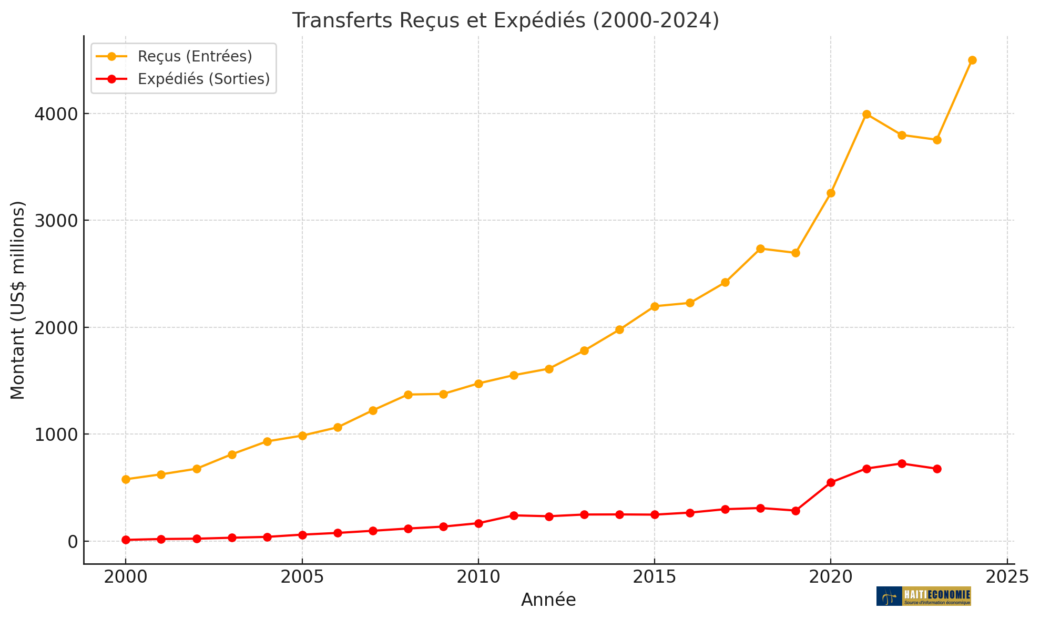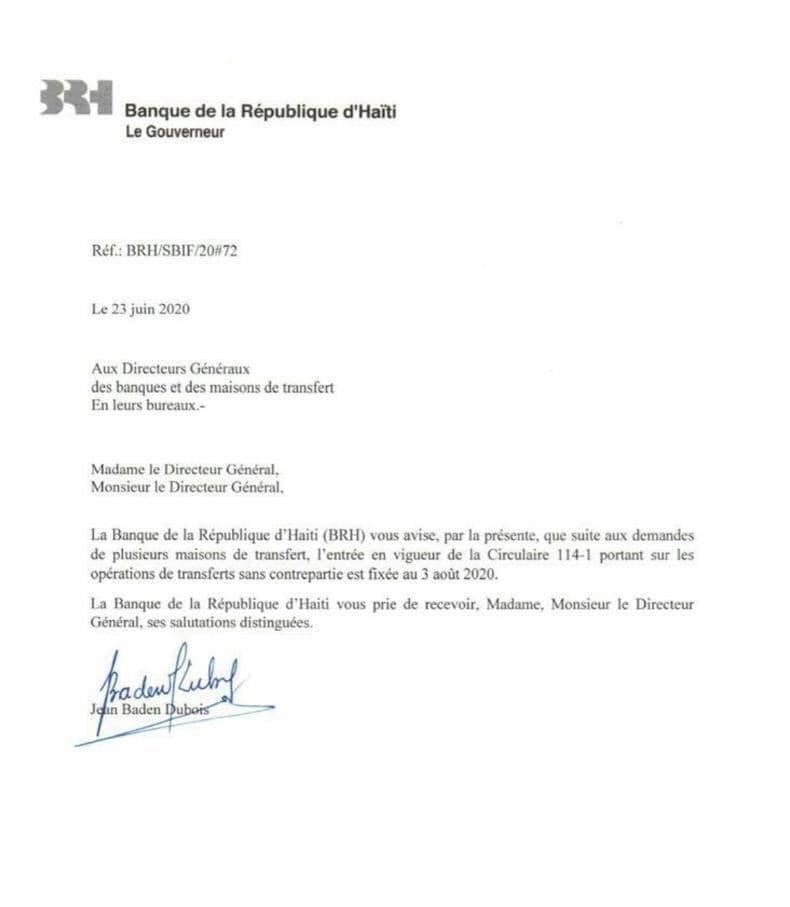Le 19 juin 2020, la Banque de la République d’Haïti (BRH) a publié la Circulaire 114-1 modifiant certaines dispositions du décret du 6 juillet 1989 concernant l’opération les maisons de transfert.
Banque de la République d’Haïti BRH Circulaire 114-1
AUX BANQUES ET MAISONS OE TRANSFERT
Conformément aux articles 2 et 3 du décret du 5 juin 2020 modifiant certaines dispositions du décret du 6 juillet 1989 sur les maisons de transfert et a l’article 161 de la loi du 14 mai 2012 sur les banques et autres institutions financières, la présente circulaire définit les normes relatives aux opérations de fonds sans contrepartie.
- Des modalités de transfert
- 1 Des transfers reçus
Les banques et les maisons de transfert sont tenues de payer les transferts internationaux :
- en monnaie étrangère si le bénéficiaire reçoit les fonds sur son compte bancaire (en dollars américains);
- en gourdes si le bénéficiaire requiert le paiement à n’importe quel point de service (succursale, agence, bureau, kiosque) sur le territoire national.
Les paiements en gourdes se font au taux de référence public par la BRH quotidiennement.
Lors du paiement d’un transfert, les banques el les maisons de transferts doivent identifier leur client habituel ou occasionnel, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, et remette au client un reçu de la transaction. Le reçus doit contenir entre autres le montant et la monnaie dans laquelle le transfert a été paye, le taux de change de la transaction, le nom de la banque ou de la maison de transfert ainsi que l’adresse du point de service ayant effectué l’opération.
Les banques et les maisons de transfert sont tenues d’afficher le taux de référence de la BRH visiblement dans leurs locaux. Elles doivent s’assurer que tous leurs points de service gérés par des tiers, appelés « sous agents », affichen1ce taux dans un endroit visible de leurs locaux.
1.2. Des transferts expédiés
Lors de rexpedition des transferts vers l’étranger, au cas où le client n’a pas de ressources en dollars, les banques et les maisons de transfert sont tenues d’effectuer la transaction au taux moyen d’acquisition (TMA) du marché (taux de vente moyen du système bancaire), public par la BRH quotidiennement.
Les banques et les maisons de transfert sont tenues d’afficher le TMA visiblement dans leurs locaux. Elles doivent s’assurer que tous leurs points de service gérés par des tiers, appelés « sous-agents », affichent ce taux dans un endroit visible de leurs locaux.
1.3. De la gestion des ressources
Pour s’assurer du paiement des transferts en gourdes, les maisons de transfert sont dans l’obligation de solliciter de leurs institutions financières les ressources nécessaires. La contrepartie des paiements effectués par toute maison de transfert doit être remise à son institution financière, sans majoration de coûts.
Les correspondants étrangers sont tenus de remettre en dollars américains à leurs agents autorisés (banques, maisons de transfert) les fonds reçus des expéditeurs.
2. Des principes lies au service de transfert de fonds
Les banques et les maisons de transfert doivent signer des contrats de représentation avec les tiers ou sous-agents, à qui ils permettre d ‘effectuer, pour leur compte et sous leur entière responsabilité, renvoi de fonds
Ces contrats doivent préciser entre autres les opérations que les sous-agents peuvent réaliser pour le compte de la banque ou de la maison de transfert, les responsabilités des parties, les modalités opérationnelles relatives au paiement des transferts à l’envoi de fonds.
Lors de la conclusion de contrats de représentation pour des services de transfert avec des entreprises commerciales, les banques et les maisons de transfert doivent :
a) s’assurer de leur honorabilité et de leur intégrité ;
b) établir leur profil de risque en tenant compte entre autres du secteur d’activités, de la zone géographique, de leur chiffre d’affaires mensuel ;
c) contrôler quotidiennement les opérations de transfert qu’elles effectuent en relation avec leur profil de risque ;
d) assumer entièrement la responsabilité de leurs actions ou omissions, tant qu’elles se rapportent aux services de transfert fournis par ladite entreprise ;
e) s’assurer du respect des règles de conformité relatives à la lune contre le blanchiment de capitaux el le financement du terrorisme ;
f) contribuer à leur formation notamment en matière de lune contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Les entreprises commerciales fonctionnant dans le secteur des jeux de hasard notamment les loteries, borlettes, casinos, et toutes autres catégories d’entreprises évoluant dans ce secteur, ne peuvent en aucun cas être des sous-agents d’aucune institution financière.
Les installations commerciales des sous-agents doivent faire clairement apparaitre leur qualité et le nom de ou des institutions financières pour lesquelles ils opèrent. Les sous-agents doivent afficher de manière visible et lisible ii leurs guichets les conditions tarifaires appliquées à la clientèle.
Les banques et les maisons de transfert sont responsables, vis-à-vis des clients, de leur réseau de sous agents, nonobstant toute disposition contractuelle contraire.
3. Des opérations menées par les sous-agents et de leur contrôle
Les banques et maisons de transfert sont tenues de remettre en gourdes a leurs sous-agents les montants payés par ces derniers aux bénéficiaires des transferts.
Les banques et les maisons de transfert doivent établir pour chaque sous-agent sa capacité journalière de paiement de transfert. Elles doivent s’assurer que le montant des transactions effectuées par lesdits sous-agents correspond à leur capacite de paiement
Les banques et les maisons de transfert sont tenues de faire appliquer la présente circulaire par leurs sous-agents.
En cas de non-respect par un sous-agent des dispositions de la présente circulaire, les banques el les maisons de transfert sont tenues de faire parvenir à la BRH trimestriellement la liste des contrevenants et les mesures prises à leur encontre. En cas de résiliation de contrat, la BRH doit en être informée ainsi que des motifs au plus tard trois (3) jours ouvrables à compter de la date de prise d’effet de la décision. La BRH en avise les banques et les maisons de transfert.
Aucun sous-agent dont le contrat a été résilié pour violation des dispositions de la présente circulaire ne peut agir à titre de représentant d’une institution financière pour des services de transfert de fonds.
4. Rapports
Les banques et les maisons de transfert sont tenues de compléter et faire parvenir à la BRH un rapport trimestriel contenant la liste de tous leurs points de services incluant les informations ci-après : nom du représentant, adresse, volume de transfert payé mensuellement (Annexe I), au plus tard quinze ( I5) jours après la fin du trimestre.
5. Sanctions
En cas de non-respect des obligations définies dans la présente circulaire, l’institution concernée s’expose aux pénalités suivantes :
a) Fiabilité de l’information
En tout temps, les montants déclarés dans le formulaire prévu en annexe doivent être ceux apparaissant dans les livres comptables de l’institution. Si les montants ne concordent pas, la BRH peut, après enquête sur les circonstances ct la nature de la violation, imposer une pénalité de 50% de la différence entre les montants déclarés et les montants apparaissant aux livres comptables.
b) Retard de production de rapport
A défaut de fournir, dans le délai requis, les rappons de conformité prévue a la section 4 de la présente circulaire, les institutions concernées encourent de cinquante mille gourdes (HTG 50,000.00) par jour d’infraction. La période de pénalité s’étend du jour où les rappons auraient dû être transmis a la BRH au jour où celle-ci les reçoit.
c) Autres
Pour toute autre infraction constatée, la BRH demandera la cessation immédiate de la pratique incriminée, prendra des sanctions administratives notamment une lettre de blâme à l’encontre de l’institution fautive et pourra appliquer une amende de cent mille gourdes (HTG I00,000.00) pour chaque fait relevé.
Toute amende sera déduite du solde de run des comptes de la banque fautive a la BRH. Par contre, le paiement de toute amende par une maison de transfert se fera par chèque de direction à l’ordre de la Banque de la République d’Haïti, au plus tard trois (3) jours ouvrables, après réception de l’avis lui exigeant le paiement. En cas de non-paiement dans les délais, des pénalités additionnelles de retard seront appliquées, soit deux mille cinq cent gourdes (HTG 2500.00) par jour de retard.
6. Abrogation et entrée en vigueur
La présente circulaire abroge la circulaire 114 du 10 juillet 2019. Elle entre en vigueur le 24 juin 2020.
Port-au-Prince, le 19 juin 2020
Jean Baden Dubois Gouverneur
Circulaire 114-1